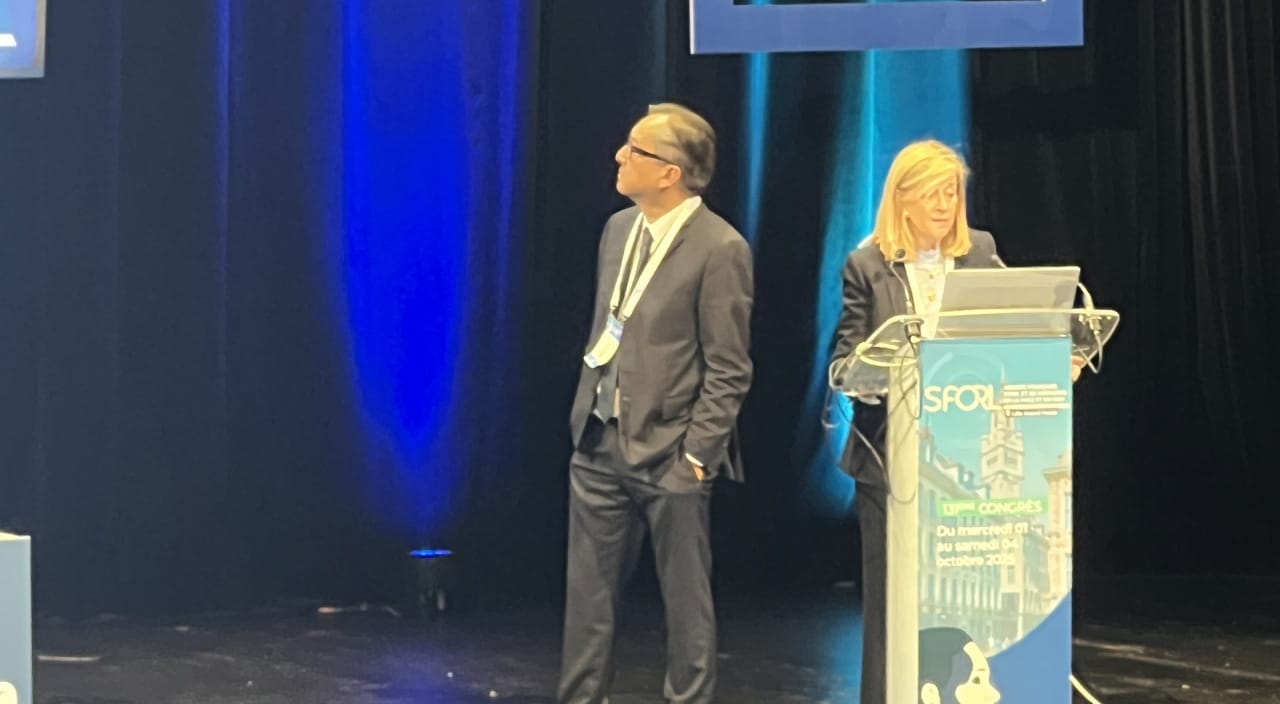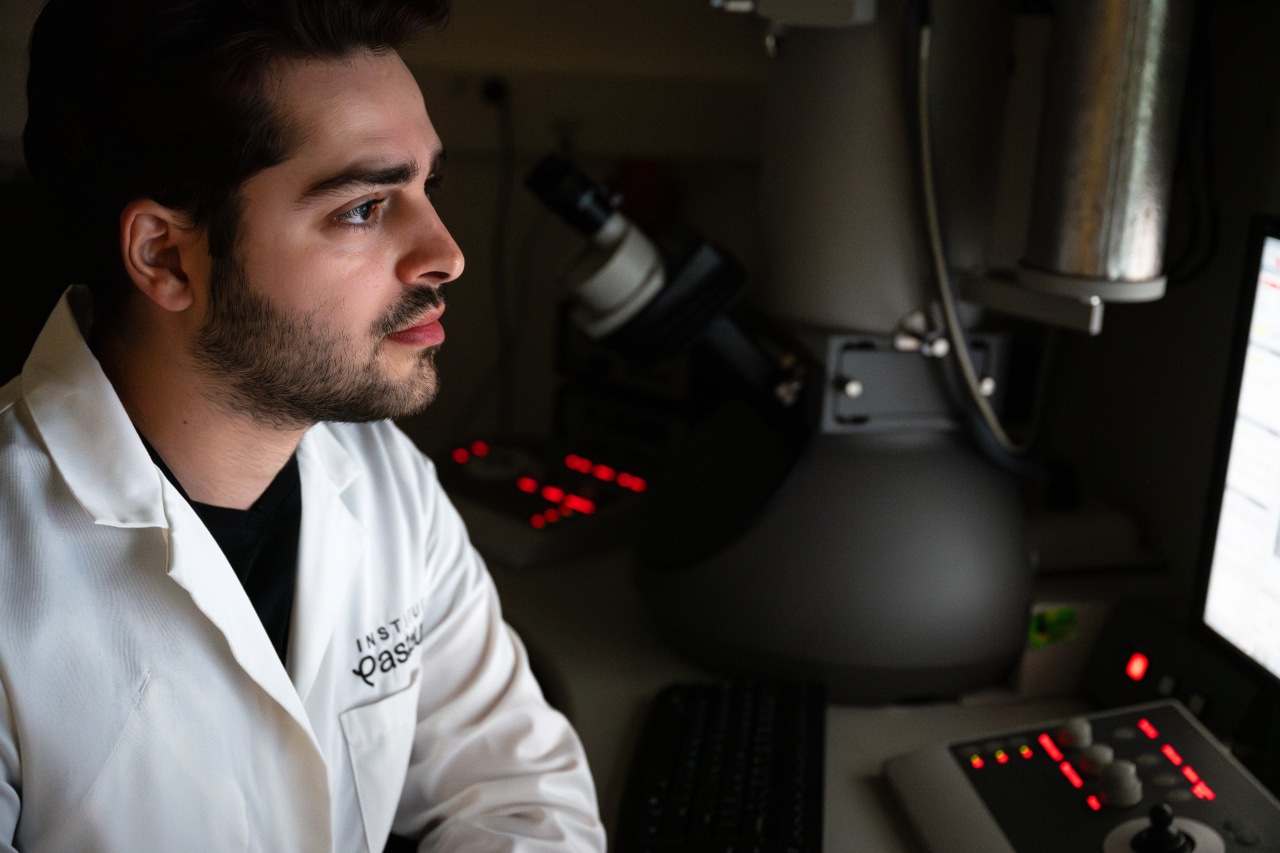Comment la maladie de Ménière bouleverse la vie quotidienne et la santé mentale des patients
Les scientifiques en ont désormais la preuve : la maladie de Ménière ne se limite pas à des vertiges. Elle entraine directement des conséquences psychologiques importantes, comme du stress, de l'anxiété, de la fatigue, des troubles cognitifs et des épisodes dépressifs. Ces conséquences ne sont pas dues à un problème psychologique préexistant, c'est la maladie elle-même qui bouleverse le psychisme des patients, déjà ébranlé par l'incertitude du diagnostic. Entre errance médicale et détresse psychologique, le parcours des patients atteints de Ménière reste difficile.

La maladie de Ménière provoque des symptômes tellement impressionnants que les patients peuvent avoir tendance à s'isoler.
Vivre avec Menière est un enfer pour ceux qui en souffrent. Cette maladie provoque des crises de vertiges aigües très pénibles qui peuvent survenir à tout moment : tête qui tourne, crise de vomissement, bourdonnement dans les oreilles… le malade en ressort complètement épuisé, physiquement mais aussi – et surtout – psychologiquement. Ce constat peut d’ailleurs s’élargir à toutes les maladies vestibulaires qui peuvent provoquer ce type de conséquences.
Une ORL témoigne
La professeure Cécile Parietti-Winkler, ORL au CHU de Nancy et secrétaire générale adjointe du CNP ORL, a elle-même vécu un épisode de vertige, non relié à une atteinte de type Menière pour autant. Cela lui a malgré tout permis de témoigner de la violence des crises lors d’une conférence aux Assises d’ORL 2025, à Cannes : « J’ai déjà fait une crise vertigineuse aigüe et j’ai cru mourir. À postériori, cela peut vraiment rendre fragiles les plus solides d’entre nous. » Ainsi, même les personnes en bonne santé, solides sur le plan psychologique, peuvent se sentir totalement déstabilisées lorsqu’une crise survient, d’autant plus si cela se produit fréquemment.
D’après la littérature scientifique, l’atteinte vestibulaire agit comme une atteinte soudaine de l’individu dans son intégrité fondamentale, souligne Cécile Parietti-Winkler. Le malade perd le contrôle de son corps et de ses mouvements, ce qui provoque un handicap très important dans sa vie quotidienne. Certaines études vont même jusqu’à qualifier ces crises de psychotrauma. « En cas d’atteinte vestibulaire, il y a une anxiété et une hyperémotivité, en dehors de tout contexte psychopathologique antérieur. » Autrement dit, le stress et les émotions intenses observés chez ces patients ne dépendent pas d’un problème psychologique préexistant. C’est la maladie elle-même qui déclenche ce bouleversement émotionnel. « La question de savoir qui de l’œuf ou de la poule est désormais tranchée », insiste la professeure Parietti- Winkler.
Détresse liée à l’errance médicale
Si des traitements existent, l’origine de la maladie de Ménière reste un mystère qui échappe aux chercheurs et aux praticiens.
« Trop de médecins sont encore peu formés sur cette pathologie et peinent à répondre aux patients qui viennent les consulter, déplore le président de l’association France Acouphènes, Jacques Foenkinos, lui-même atteint de Ménière. Il y a souvent une longue errance médicale avant d’être diagnostiqué. Encore aujourd’hui, beaucoup de patients vont à un rendez-vous médical pour s’entendre dire qu’on ne peut rien pour eux, alors que des solutions existent. Cela ne doit plus arriver ! C’est très pénible et nous sommes dès le départ sur la pente savonneuse. Cela provoque une grande détresse psycho- logique, car le patient n’est pas compris et ne sait pas ce qu’il a. » « De plus, il n’y a que du déclaratif sur les vertiges, comme pour les acouphènes, c’est-à-dire que ce qu’on vit et ressent ne peut pas être prouvé, c’est invisible. Il n’y a pas d’analyses de sang ou de radios », poursuit Jacques Foenkinos. Certes, cinq IRM en France permettent désormais de visualiser l’hydrops et de prouver potentiellement une atteinte vertigineuse, mais obtenir un rendez-vous reste compliqué, ce qui alimente la frustration et le sentiment d’incompréhension, selon lui. La professeure Cécile Parietti-Winkler le confirme : « Quand un patient consulte un ORL, par exemple pour une maladie de Ménière, et demande de quoi il est atteint, si le médecin répond qu’il ne sait pas vraiment, ni comment la maladie va évoluer, ni quels traitements sont possibles. Cela crée une forte angoisse. » Une incertitude qui pèse lourd sur le psychisme du patient, en plus des répercussions physiques des crises.
Crainte de la prochaine crise
Les patients atteints par la maladie de Ménière, tout comme ceux souffrant d’autres troubles vestibulaires chroniques, vivent avec la crainte constante de subir leur prochaine crise, ce qui constitue un défi psychologique considérable.
« Les crises sont tellement fortes que le patient vit dans la crainte du prochain épisode », explique le professeur Vincent Darrouzet, ORL au CHU de Bordeaux. Chaque nouvelle crise renforce la peur de la suivante, créant un cercle vicieux difficile à interrompre, précise-t-il : « Quand le patient subit une crise, il reste plusieurs heures alité, il vomit partout, cela provoque une angoisse considérable. Or cette anxiété anticipatoire est un mécanisme qui aggrave les symptômes de la maladie. »
« Cela peut conduire à des situations de stress intense, par exemple lorsqu’un médecin pratique une manœuvre, ce qui peut amplifier les troubles de l’équilibre et favoriser l’apparition d’une nouvelle crise », souligne la professeure Parietti- Winkler. Cette anxiété constante peut s’accompagner de ce que les spécialistes appellent l’hypervigilance, qui pèse aussi sur les fonctions cérébrales. « Le patient se concentre sur ses symptômes et un éventuel problème à venir, précise-t-elle. La moindre sensation inhabituelle peut être interprétée comme le signe annonciateur d’une crise, renforçant le stress et la peur, empêchant une véritable récupération entre les épisodes. »
Isolement, dépression et risque suicidaire
La vie sociale et les activités quotidiennes des patients atteints de Ménière s’en trouvent profondément affectées, avec une forte tendance à l’isolement. « On se dit qu’il n’y a pas de raisons que la crise ne revienne pas encore et encore, donc on s’enferme, on ne déjeune plus avec ses amis, on ne sort plus », témoigne le professeur Vincent Darrouzet. Pour Jacques Foenkinos, ce repli est aussi lié à la peur du regard des autres : « Les malades se mettent dans une prison après les premières crises, craignant qu’un épisode de vomissements et de prostration survienne en public. Cela crée à tort un sentiment de honte. »
Face à cela, l’association France Acouphènes encourage les patients à reprendre contact avec le monde extérieur. « Récemment, nous avons aidé une femme atteinte de Ménière, qui n’était pas sortie de chez elle depuis neuf mois, raconte son président, Jacques Foenkinos. Elle a commencé par participer en physique à des groupes de parole. Au début, elle était complètement déprimée et n’osait plus parler, mais elle a petit à petit retrouvé le sourire. » Très souvent, les malades souffrent d’une dépression secondaire, c’est-à-dire directement liée à la maladie. « La dépression survient en réaction aux symptômes, l’anxiété qu’elle génère pouvant elle-même influencer les vertiges, car le patient se met une pression psychique qui affecte les pressions de l’oreille interne », explique le professeur Darrouzet. Dans les cas les plus extrêmes, le désespoir et l’isolement d’un malade de Ménière peuvent aller jusqu’au suicide. Jacques Foenkinos prévient : « Si personne ne nous sort de la prison qu’on s’est créée, les conséquences peuvent être dramatiques. Nous avons malheureusement été confrontés à ce genre de cas et cela ne doit plus se reproduire. »
Un impact de Ménière sur la cognition scientifiquement prouvé
Quand les troubles de l’équilibre deviennent chroniques, ils affectent directement le fonctionnement du cerveau. Les scientifiques en ont aujourd’hui la preuve grâce à plusieurs études récentes en neuro-imagerie et en neurosciences. « Les centres vestibulaires, qui contrôlent l’équilibre, sont situés à proximité immédiate des zones cérébrales impliquées dans la mémoire, la concentration ou encore la perception de son niveau intellectuel, explique le professeur Vincent Darrouzet. C’est cette proximité anatomique qui explique que la maladie de Ménière puisse entrainer des troubles cognitifs. »
Ainsi, la baisse de l’attention, les difficultés de mémoire ou l’impression d’une fatigue intellectuelle reposent sur un mécanisme neurologique aujourd’hui bien identifié. Deux études parues en 2024 ont d’ailleurs mis en évidence les connexions entre les voies vestibulaires et les zones cérébrales de la mémoire, de l’attention et des fonctions exécutives (« Cognition in vestibular disorders: state of the field, challenges, and priorities for the future »1 et l’éditorial « Vertigo, Tinnitus, and cognition » de la revue Frontiers in Neuroscience2).
Il est à noter que les personnalités anxieuses ou très exigeantes sont plus susceptibles de développer la maladie de Ménière, « par exemple, si vous êtes quelqu’un de très précis, très exigeant avec vous-même, qui ne voulez pas qu’un objet soit à tel endroit sur la table », précise le professeur Darrouzet. La maladie de Ménière sera encore plus mal vécue par ce type de personnalité.
La maladie de Ménière, c’est quoi ?
Ménière est une maladie chronique due à une augmentation de la pression des liquides dans l’oreille interne. Elle se caractérise par trois symptômes : des crises vertigineuses intenses et imprévisibles, des acouphènes souvent invalidants et une perte auditive fluctuante qui tend à s’aggraver avec le temps. Rare (elle toucherait 7,5 Français sur 100 000), la maladie survient généralement entre 30 et 60 ans, mais elle peut apparaitre à tous les âges de la vie. Elle est cependant plus rare chez les enfants et les adolescents. Les crises peuvent durer de quelques minutes à plusieurs heures. La personne a l’impression que tout tourne autour d’elle, ce qui provoque des nausées pouvant aller jusqu’à des vomissements. L’origine de la maladie de Ménière, du nom du médecin qui l’a pour la première fois décrite, reste inconnue, malgré 150 ans de recherches. « Toutefois, une chose est désormais sure : il ne s’agit pas d’une maladie psychosomatique. Au départ, ce n’est pas le psychisme qui dérègle le fonctionnement du système de l’équilibre », précise le professeur Darrouzet. La maladie Ménière représente moins de 10 % des vertiges, ce qui la place loin derrière les vertiges positionnels paroxystiques (50 % des vertiges) ou les névrites vestibulaires.
 Se connecter
Se connecter